La notion de culture
« Ne doutez jamais qu’un petit groupe de personnes peuvent changer le monde. En fait, c’est toujours ainsi que le monde à changé. »
Margaret MEAD, Mœurs et sexualité en Océanie, Paris, Plon, 1963
Margaret MEAD, anthropologue américaine très réputée et militante féministe, est née à Philadelphie en 1901 d’un père économiste, professeur à l’université de Pennsylvanie, et d’une mère diplômée de sociologie. En 1921, elle entreprend des études de psychologie et d’anthropologie à l’université Columbia, où elle deviendra par la suite professeure associée, tout en poursuivant sa carrière à l’American Museum of Natural History.
En 1925, Margaret MEAD part pour Samoa, puis dans les îles de l’Amirauté. De 1931 à 1933, elle étudie la personnalité culturelle de trois tribus de Nouvelle-Guinée. Ce séjour sera à l’origine du livre qui nous intéresse ici : Mœurs et sexualité en Océanie. Elle séjournera ensuite à Bali, puis chez les latmul de Nouvelle-Guinée.
Elle fut, avec son mari Gregory BATESON, une pionnière de l’usage documentaire de la photographie dans l’enquête ethnographique. Elle a contribué à la diffusion d’une conception humaine de l’anthropologie. Margaret MEAD est morte en 1978 à New York.
Dans Mœurs et sexualité en Océanie, Margaret MEAD compare trois tribus de Nouvelle-Guinée dont les orientations culturelles sont très différentes (Arapesh, Mundugumor, Chambuli). Elle y aborde « la question des différences biologiques liées au sexe », et nous décrit le comportement des hommes et des femmes selon la culture dans laquelle ils ont été élevés. Margaret MEAD pense que « les méthodes d’éducation, la structure de la personnalité adulte, les orientations fondamentales de la culture forment un ensemble organisé et indissociable dont l’étude invite à repenser la place de ce qui est de l’ordre du “naturel” au sein de chaque culture ».
C’est ce qu’elle tente de démontrer dans la suite de son exposé, dont nous nous efforcerons, ici, de restituer les grands traits.
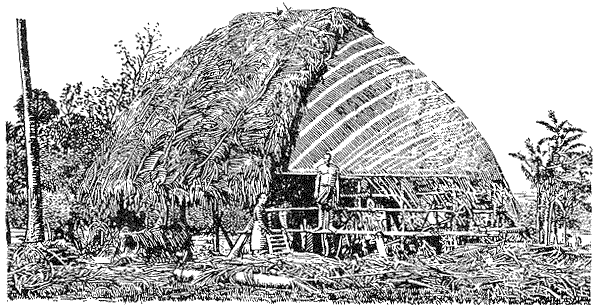
Les montagnards Arapesh
La première partie du livre est consacrée à la société des montagnards Arapesh qui sont un peuple pacifique où hommes et femmes font montre de douceur, de sensibilité et de serviabilité. Pour un Arapesh, concevoir un enfant est une œuvre commune du père et de la mère qui exige beaucoup d’attention et de minutie. L’enfant étant le produit du sperme du père et du sang maternel, le couple doit avoir des rapports sexuels continus, pendant plusieurs semaines, à partir du moment où il décide de concevoir un bébé. Mais, de la conception jusqu’à ce que l’enfant fasse ses premiers pas, les rapports sexuels sont proscrits. Le tabou relatif à ces rapports sexuels ne sera levé qu’après le jeûne des parents.
Pour accoucher, la mère se retire avec d’autres femmes dans la hutte menstruelle. Le père n’assiste pas à l’accouchement, de manière à éviter de mettre en contact le sang de la mère et les fonctions magiques et alimentaires de l’homme. Au retour de la mère et de l’enfant dans le village, le père vient aider sa femme à s’occuper du bébé. Le premier jour, l’homme et la femme dorment ensemble près du bébé et veillent sur lui. Ce jour est aussi un jour de jeûne et d’accomplissement de rites magiques pour les parents. La mère allaite son enfant jusqu’à l’âge de trois ou quatre ans, à moins qu’elle ne soit de nouveau enceinte. Dans ce cas, d’autres femmes du groupe se chargeront d’allaiter le petit. Les parents Arapesh trouvent cruel de sevrer un enfant trop tôt ; ils pensent que cela peut nuire à sa croissance. Pendant ses trois premiers mois de vie, le nouveau-né ne reste jamais loin des bras de quelqu’un. Sa mère le porte dans un sac filet où il reste en contact étroit avec elle. L’enfant grandit entouré de tendresse et de sollicitude. Il n’est soumis qu’à deux chocs à cette période : la surprise d’un jet d’eau froide dont on l’asperge, après les premières semaines pendant lesquelles il a été lavé avec précaution dans de l’eau tiède, et une vive secousse venant interrompre le cours normal de l’excrétion. Les Arapesh éduquent leurs enfants dans la confiance. Jusqu’à l’âge de cinq ans, filles et garçons sont indifféremment élevés par la mère et par le père. Le père tout autant que la mère possède par son éducation les gestes maternels tels que le monde occidental les attribue généralement aux femmes.
À l’âge de cinq, six ans, l’éducation du petit garçon tend sensiblement à se différencier de celle de la petite fille, en ce sens qu’il est obligé de ne plus s’adonner à son passe-temps favori : jouer avec sa bouche et ses lèvres. Dans le même temps, la petite fille, elle, peut continuer à le faire, et ce jusqu’à la naissance de son premier enfant. À cet âge-là, le petit garçon tend plus à s’attacher aux pas de son père, et la petite fille à sa mère. Chez les Arapesh, ceux qui souffrent le plus, ceux qui ont le plus de mal à se faire à ce système social, sont les personnes qui laissent libre cours à la violence et à l’agressivité, qu’ils soient hommes ou femmes.
Une tribu riveraine : les Mundugumor
Les Mundugumor sont une tribu cannibale dans laquelle les hommes s’adonnent à la « chasse aux têtes », et s’occupent de l’organisation des fêtes et des parades, alors que les femmes font du jardinage, de la culture de tabac, et s’occupent de la pêche. Cette société vit dans une atmosphère de méfiance et d’inquiétude. Ce qui leur fait adopter un habitat dispersé dans la brousse. Leur système de parenté est la « corde » qui lie : d’un côté un père, sa fille et le fils de la fille, et de l’autre côté : une mère, son fils et la fille du fils. Tous les biens à l’exception de la terre sont transmis en lignée patrilinéaire ; la fille, qui est apparentée au père, héritant de tout le reste, même des armes.
L’idéal social chez les Mundugumor est la grande famille polygame : un homme pour six ou sept épouses ; les épouses étant un signe de richesse et de puissance. Ces groupes de femmes forment une organisation semi-corporatiste à l’intérieur de laquelle sévit la rivalité. Les hommes comme les femmes ne respectent aucune de leurs propres règles ; il y existe une grande désorganisation sociale et religieuse. Les femmes sont le principal sujet de discorde. La chasse aux têtes et les fêtes qui la suivent sont les seuls moments où règnent un peu de calme et de solidarité.
La naissance chez les Mundugumor n’est pas un moment de réjouissance, car, pour la femme, elle signifie que son mari va se détourner d’elle pour aller vers une autre femme. Pour l’homme, c’est la naissance qui pose problème. S’il naît un enfant de sexe masculin, il sera considéré comme rival par son père. Si c’est une fille, elle sera considérée comme une simple charge, puisque seul le fils, et donc son frère, aura des droits, du fait de la structure de la parenté Mundugumor.
Dans cet univers hostile, quand vient à naître un enfant, il ne survit que s’il en a la force, car, dès le jeune âge il doit s’affirmer, « se faire sa place ». La tétée, en cela, est la première épreuve : elle ne s’accompagne d’aucun jeu, et n’est pas prolongée au-delà du nécessaire. Très tôt, les petites filles apprennent à se faire admirer, et se couvrent de bijoux. Elles sont soumises à des règles plus souples, et ont de meilleures relations entre elles. À l’adolescence, elles sont plus surveillées, à cause des rivalités entre hommes au sujet des femmes. Les garçons, eux, vont nus jusqu’à l’âge de sept-huit ans. Les premières choses qui sont apprises à un garçon sont une série d’interdictions. Dès l’âge de quatre ans, on lui apprend à distinguer les différents membres de sa famille. Il arrive qu’à l’âge de huit-neuf ans, un petit garçon soit donné en otage à une tribu étrangère, pendant que des tractations se font pour une chasse aux têtes. Ces expériences que subissent un petit nombre de jeunes garçons rendent peu homogène leur groupe. Avant l’adolescence, le garçon doit mettre à mort un prisonnier destiné à un festin de chair humaine. À l’âge de douze-treize ans, les enfants ont pratiquement assimilé les valeurs individualistes de leur société.
Les Mundugumor acceptent mal les mariages entre générations, qu’ils considèrent comme une sorte d’inceste. Ils attachent beaucoup d’importance à la virginité, même si beaucoup de filles ont des relations avant le mariage. Les couples s’adonnent à un certain exhibitionnisme, en allant faire l’amour dans la brousse où ils peuvent être vus, et donner cours à leur violence.
Une tribune lacustre : les Chambuli
La société Chambuli est de structure patrilinéaire-polygame. Les hommes y achètent leurs femmes. L’organisation est clanique, et les rapports difficiles entre les hommes. L’enfant qui vient à naître n’est jamais seul. À sept-huit ans, le petit garçon commence à s’intéresser à la vie cérémonielle des hommes. Entre huit et onze ans, il a le dos scarifié. Alors que les femmes évoluent dans un groupe ou l’atmosphère est à la camaraderie, les hommes quant à eux sont tendus, et méfiants les uns vis-à-vis des autres. Les femmes, par leur activité, possèdent une grande puissance sociale ; et, dans les rapports sexuels, ce sont elles qui prennent l’initiative.
On note une complexité dans le rapport entre les deux sexes : « Les hommes sont nominalement chefs de famille, propriétaires, mais, en réalité, ce sont les femmes qui détiennent pouvoir et initiative ». Les jeunes et les hommes plus âgés se disputent les faveurs des femmes. Le mariage est en principe conclu sur la base de liens émotionnels et de liens de sang. Jusqu’à six-sept ans, filles et garçons sont élevés de la même façon, sans différenciation. À partir de là, la petite fille apprend les rôles et tâches dévolues aux femmes, alors que le garçon n’apprend aucun rôle, et se trouve « dans un entre-deux » : il est alors trop âgé pour rester dans le groupe des femmes toute la journée, et trop jeune pour participer aux occupations des hommes. Pendant cette période, de l’âge de huit à l’âge de onze-douze ans, les garçons sont exclus, ce qui leur donne le sentiment d’être négligés.
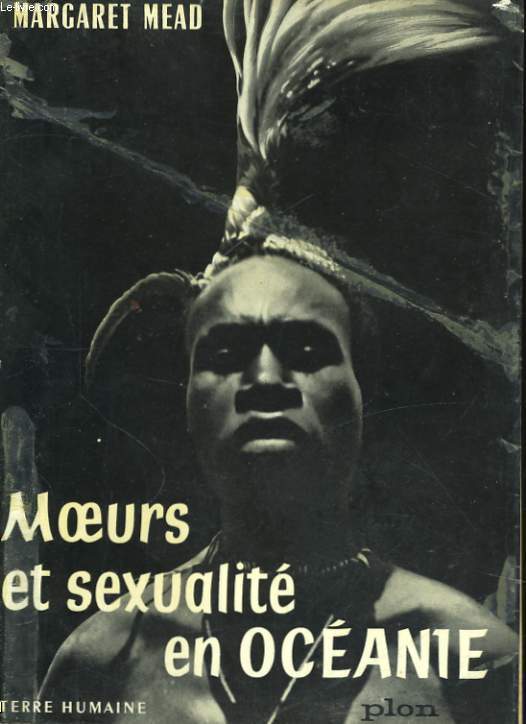
Que nous apprend cette comparaison ?
« Si certaines attitudes, que nous considérons comme traditionnellement associées au tempérament féminin – telles que la passivité, la sensibilité, l’amour des enfants –, peuvent si aisément être typiques des hommes d’une tribu, et, dans une autre au contraire, être rejetées par la majorité des hommes comme des femmes, nous n’avons plus aucune raison de croire qu’elles soient irrévocablement déterminées par le sexe de l’individu. Cette conclusion s’impose avec d’autant plus de force que les Chambuli ont inversé les rôles, tout en conservant officiellement des institutions patrilinéaires. »
Ni les Arapesh ni les Mundugumor n’ont réservé à un sexe ou à l’autre certaines attitudes spécifiques. Ni la naissance ni les hasards de sa condition n’obligent l’individu à se comporter d’une manière prédéfinie.
J’ai choisi de partager mes notes sur ce livre de Margaret MEAD avec vous, pour offrir un « grand angle », et agrandir les positions de perceptions que nous pouvons tous avoir dans notre vie. J’espère vous avoir donné l’envie, si ce n’est de lire ce livre, du moins de vous poser des questions sur votre éducation. En revisitant votre passé, vous pouvez décider en toute conscience de ce que vous voulez conserver et de ce que vous voulez « lâcher », pour libérer de la place dans le « sac à dos » de votre vie.